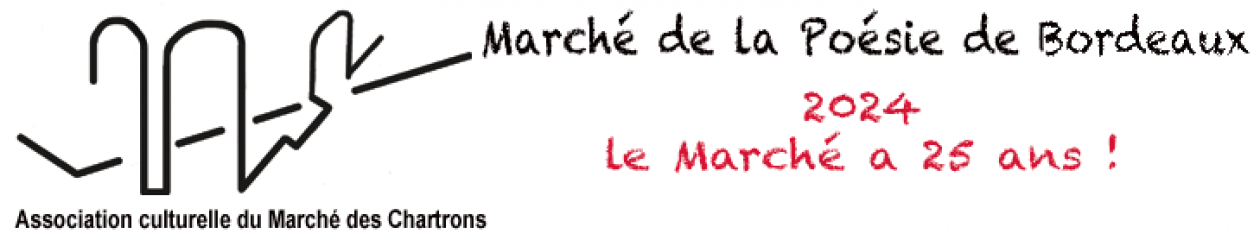Bien fou celui qui, tombé, repart et marche avec nous,
qui meut, errante douleur, ses chevilles, ses genoux,
mais lui se remet en route comme un que portent des ailes,
rester, il n’ose le faire, en vain le fossé l’appelle,
si l’on demandait pourquoi, peut-être parlerait-il
de la femme qui l’attend, d’un beau trépas plus subtil,
mais c’est encor, le crédule, être fou : depuis le temps
sur nos maisons ne circule que le vent, le vent brûlant,
les murs ne sont que décombres, le prunier, brisé, n’est plus,
d’horreur, la nuit familière est comme un monstre velu.
Que ne puis-je y croire encore ! Ce n’est plus qu’un souvenir,
ce qui fait le prix de vivre, la maison où revenir,
notre vieille véranda si fraîche où l’abeille rôde,
où refroidissaient les pots tout remplis de reines-claudes,
les derniers feux de l’été, les fruits nus qui se balancent,
les vergers ensommeillés de soleil et de silence,
Fanny qui m’attend si blonde sur la rousseur de la haie;
à tracer de lentes ombres s’attarde la matinée-
oh oui, c’est possible encore ! La lune est si ronde ! Ami,
attends-moi! Crie après moi ! Je me relève, et te suis !
Bor, 15 septembre 1944 (poème extrait de Ciel écumeux)
Miklós Radnóti, Marche forcée, Œuvres, 1930-1944, traduit du hongrois par Jean-Luc Moreau, éditions Phébus