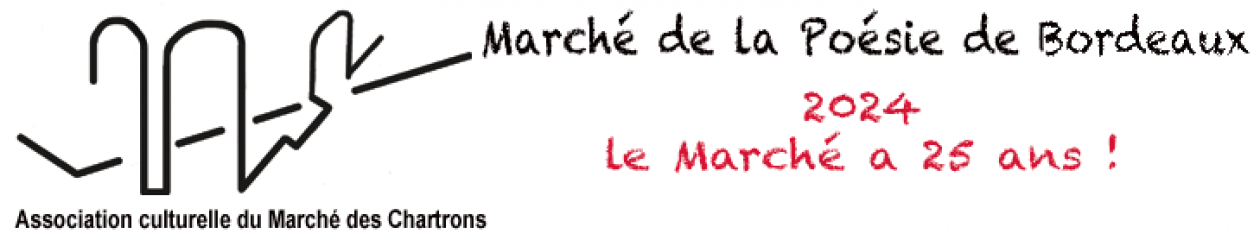La deuxième élégie
Tout ange est terrible. Et pourtant, malheur à moi,
je vous invoque, oiseaux presque mortels de l’âme,
vous connaissant. Car où sont les jours de Tobie
où le plus rayonnant de vous pouvait paraître,
à peine déguisé pour le voyage, au seuil
d’une simple maison sans provoquer l’effroi
(simple jeune homme aux yeux curieux du jeune homme) ?
Si aujourd’hui l’archange au-delà des étoiles
descendait menaçant vers nous fût-ce d’un pas :
notre cœur nous tuerait dans un sursaut. Qui êtes-vous ?
Succès premiers, enfants chéris de la création,
hautes chaînes, sommets empourprés par l’aurore
des tous débuts – pollen des floraisons divines,
jointures de lumière, escaliers, couloirs, trônes
aires d’essence, écus de délice, tumultes
d’orageuse extase et soudain, isolés,
miroirs : dont la propre beauté s’épanche à flots
pour être reversée dans leur propre visage.
Car sentir est pour nous, hélas, s’évaporer ;
tout notre être s’exhale et fuit ; de flamme en flamme
notre odeur s’affaiblit. Et tel a beau nous dire :
tu passes dans mon sang, ce printemps, cette chambre
sont pleins de toi, à quoi bon s’il ne peut nous retenir,
si nous disparaissons en lui et tout autour ?
Les êtres de beauté, qui les retient ? Sans cesse
l’apparence leur monte au visage et s’en va.
Comme rosée sur l’herbe au matin s’évapore
ce qui est nôtre, ainsi que la chaleur d’un mets
brûlant. Ô sourire, vers où ? O yeux levés,
neuve, chaude vague du cœur : elle s’échappe – ;
c’est nous pourtant, cela, hélas. L’espace où nous
nous dissolvons aurait-il notre goût ? Les anges,
vraiment, ne reprennent-ils que leur bien, ce qui
émana d’eux, ou avec, comme par mégarde,
un peu de nous parfois mêlé parmi leurs traits,
tel le vague au visage des femmes enceintes ?
Eux n’en remarquent rien, pris dans le tourbillon
de leur retour à eux. (Comment le pourraient-ils ?)
Les amants, s’ils le comprenaient, pourraient parler
dans l’air nocturne, étrangement. Car tout nous cache,
semble-t-il. Vois : les arbres sont. Et les maisons
encore, que nous habitons. Nous seuls passons auprès
de tout comme un souffle échangé. Et tout conspire
pour faire sur nous le silence, soit par honte,
peut-être, soit dans quelque inexprimable espoir.
Amants, l’un en l’autre comblés, je vous demande :
et nous ? Vous vous touchez. Mais avez-vous des preuves ?
Mes deux mains, voyez-vous, parfois prennent conscience
l’une de l’autre, en elles mon visage usé
se réfugie et j’en éprouve une légère sensation.
Qui, toutefois, oserait être pour si peu ?
Vous, en revanche, grandis dans l’extase de l’autre
jusqu’à ce que l’un de vous deux supplie, n’en pouvant plus
assez ! – vous qui entre vos mains croissez à profusion
comme le raisin dans les années d’abondance,
vous qui parfois vous effacez parce que l’autre
a grandi à l’excès, je vous demande : et nous ?
Je sais, votre contact n’est aussi bienheureux
que par l’effet de la caresse qui retient
sans que disparaisse l’endroit si tendrement
couvert par vous, car au-dessous la durée pure
vous est sensible et vous promet presque en l’étreinte
l’éternité. Pourtant, surmontée la frayeur
des premiers regards et l’attente anxieuse à la fenêtre,
les premiers pas ensemble au jardin, une fois :
amants, est-ce encor vous lorsque vous vous portez
aux lèvres l’un à l’autre, trait sur trait ? Oh comme alors
de l’acte le buveur étrangement s’évade !
La prudence du geste humain ne vous a-t-elle
jamais surpris sur les stèles attiques ?
Amour, adieu touchaient-ils pas de main légère
ces épaules, comme faits d’une autre matière
que chez nous ? Rappelez-vous ces mains qui se posent
sans peser, en dépit de la vigueur des torses.
Maîtres de soi, ces gens connaissaient leurs limites :
ce toucher si léger, c’est nous ; les dieux nous pressent
bien plus fort. Mais cela, c’est l’affaire des dieux.
Ah ! puissions-nous trouver à notre tour, étroite
bande de sol fécond entre roc et rivière,
un pur domaine humain qui dure. Car toujours,
comme ceux-là, notre propre cœur nous surpasse.
Et nous ne pouvons plus suivre du regard
en des images qui l’apaisent ni des corps
divins en qui, magnifié, il se modère.
Rainer-Maria Rilke
Traduit de l’allemand par François-René Daillie
in, Rainer-Maria Rilke : Élégies de Duino
Editions de La Différence (Orphée), 1994