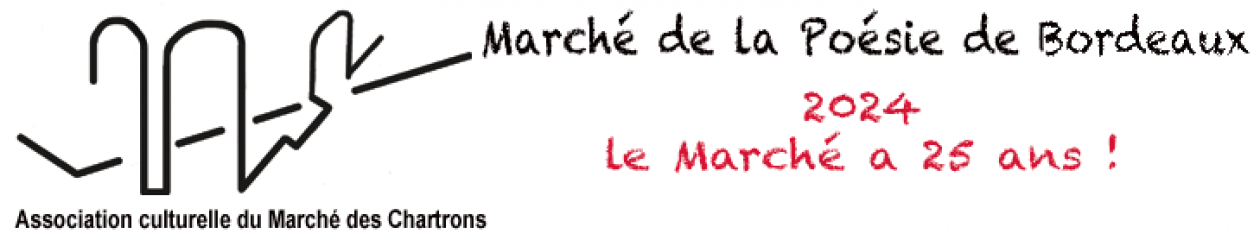[column-half-1]
Grief
Grief walks miles beside the polluted river,
grief counts days sucked into the winter solstice,
grief receives exuberant schoolyard voices
as flung despisals.
It will always be the first of September.
There will be Dominican boys whose soccer
game provides an innocent conversation
for the two people
drinking coffee, coatless. There will be sunset
roselight on the river like a cathedral.
There will be a rusty, amusing tugboat
pushing a barge home.
Did she think she knew what her friend intended?
Did she think her brother rejoiced to see her?
Did she think she’d sleep one more time till sunrise
holding her lover?
Grief has got no brother, sister or lover.
Grief finds friendship elsewhere. Grief, in the darkened
hours and hours before light flicks in one window
holds grief, a mirror.
Brother? He was dead, in a war-drained city.
Grief was shelling peas, with cold water running
in the sink; a harpsichord trilled Corelli
until the phone rang.
And when grief came home from a post-op nightwatch
two small girls looked reticent over homework.
Half the closet, half the drawers were empty.
Who was gone this time?
Grief is isolationist, short-viewed. Grief lacks
empathy, compassion, imagination;
reads accounts of massacres, floods and earthquakes
mired in one story.
Grief is individual, bourgeois, common
and banal, two women’s exchange in Sunday
market: “Le mari de Germaine est mort.” They
fill bags with apples.
Grief is primagravida, in her fifth month.
Now she knows the fetus has died inside her.
Now she crosses shopping-streets on a sun-shot
mid-winter morning.
Winter licks the marrow from streets that open
onto parks and boulevards, rivers, river-
parallel parkways, arteries to bridges,
interstates, airports.
Grief daubs kohl on middle-aged burning eyelids.
Grief drives miles not noticing if the highway
runs beside an ocean, abandoned buildings
or blackened wheatfields
—and, in fact, she’s indoors. Although her height is
average, massive furniture blocks and crowds her:
oak and pine, warm gold in their grain she thought would
ransom her season.
Workmen clear a path to repair the windows,
not with panes of light on their backs, no message-
bearers these. Still stubbornly green, a street leads
back to the river.
Fourteen years drained into the fifteen minutes
that it took a late-summer sun to douse its
light behind the opposite bank, the boys to
call their match over.
[/column-half-1]
[column-half-2]
Douleur
Douleur parcourt des lieues au bord du fleuve pollué,
douleur compte les jours happés dans le solstice d’hiver,
douleur entend les voix exubérantes de la cour d’école :
insultes qu’on lance.
Ce sera à tout jamais le premier septembre.
Il y aura les jeunes Haïtiens : leur partie de foot
fournit un sujet de conversation innocente
aux deux personnes
buvant leur café, bras nus. Il y aura la lumière
de rosace du soleil couchant sur le fleuve.
Il y aura un remorqueur rouillé, drôle,
poussant une péniche.
Pensait-elle savoir ce que projetait son amie ?
Pensait-elle que son frère se réjouissait de la voir ?
Pensait-elle dormir une fois de plus jusqu’à l’aube,
serrant contre elle son amour ?
Douleur n’a pas de frère, de sœur, ni d’amour.
Douleur trouve ailleurs l’amitié. Douleur, dans les heures
de ténèbres sans fin avant la lueur sur la vitre
tient douleur, son miroir.
Frère ? Il était mort, dans une ville saignée par la guerre.
Douleur écossait des pois, l’eau froide coulait
dans l’évier ; un clavecin trillait du Corelli
jusqu’au coup de fil.
Et quand douleur arriva d’une nuit de veille à l’hôpital,
deux filles parurent faire leurs devoirs à contrecœur.
La moitié du placard, la moitié des tiroirs étaient vides.
Qui était parti cette fois ?
Douleur est isolationniste, a la vue courte. Douleur manque
d’empathie, de compassion, d’imagination ;
lit des récits de massacres, inondations, séismes
embourbés dans un seul récit.
Douleur est individuelle, bourgeoise, ordinaire
et banale, l’échange entre deux femmes dans un marché
le dimanche : « Le mari de Germaine est mort ».
Remplissant leurs cabas de pommes.
Douleur a sa première grossesse, en est à cinq mois.
À présent elle sait que le fœtus est mort en elle.
Traverse des rues pleines de commerces un matin
strié de soleil d’hiver.
L’hiver lèche la moelle de rues qui s’ouvrent
sur des jardins et des boulevards, des fleuves, des voies
sur berge parallèles, des artères menant à des ponts,
des frontières, des aéroports.
Douleur essuie du khol sur des paupières brûlantes.
Douleur avale des lieues sans voir si l’autoroute
longe l’océan, des bâtiments à l’abandon
ou des champs de blé noircis
– et d’ailleurs elle ne sort pas. Le mobilier massif,
bien qu’elle ne soit pas petite, la bloque et la cerne :
chêne et pin dont l’or chaud du grain, croyait-elle,
allait racheter sa saison.
Des ouvriers grimpent pour réparer les fenêtres,
sans vitres de clarté sur leur dos : ici, aucun ange
porteur de messages. Obstinément verte, une rue
ramène au fleuve.
Quatorze années drainées dans un quart d’heure :
le temps pour le soleil d’été finissant de souffler
sa lumière derrière l’autre rive, pour les jeunes gens
de terminer leur match.
[/column-half-2]
Marilyn Hacker (Etats Unis d’Amérique)
–Desesperanto (2003) – A Stranger’s Mirror: New and Selected Poems, 1994-2014 (W. W. Norton Company) – La Rue palimpseste (La Différence, 2004) – Traduit de l’anglais par Claire Malroux.